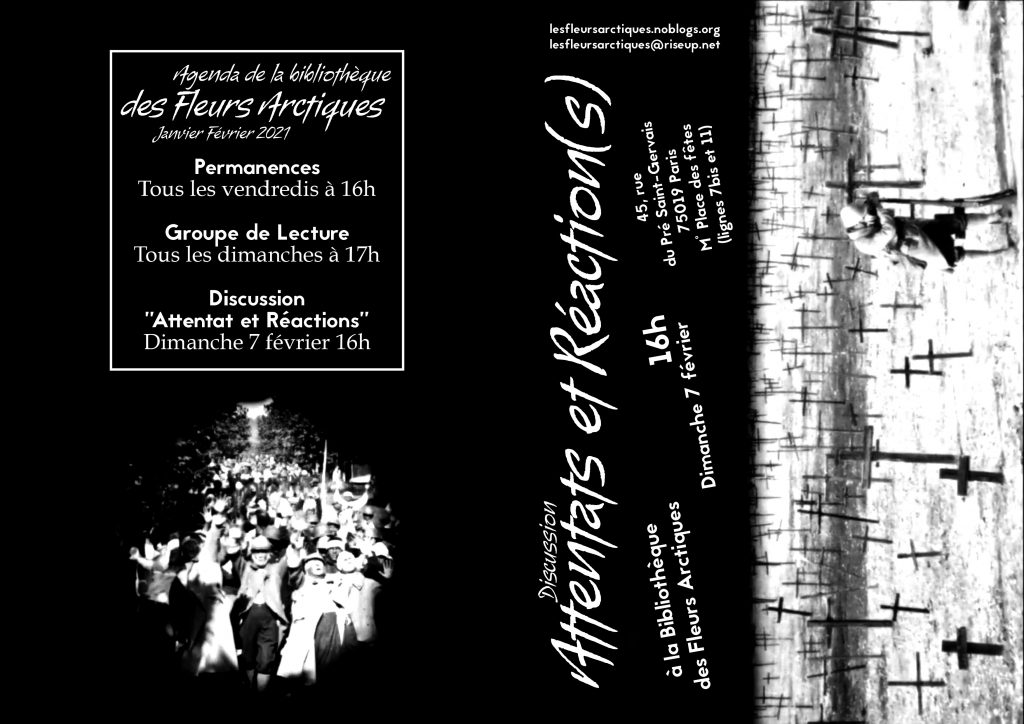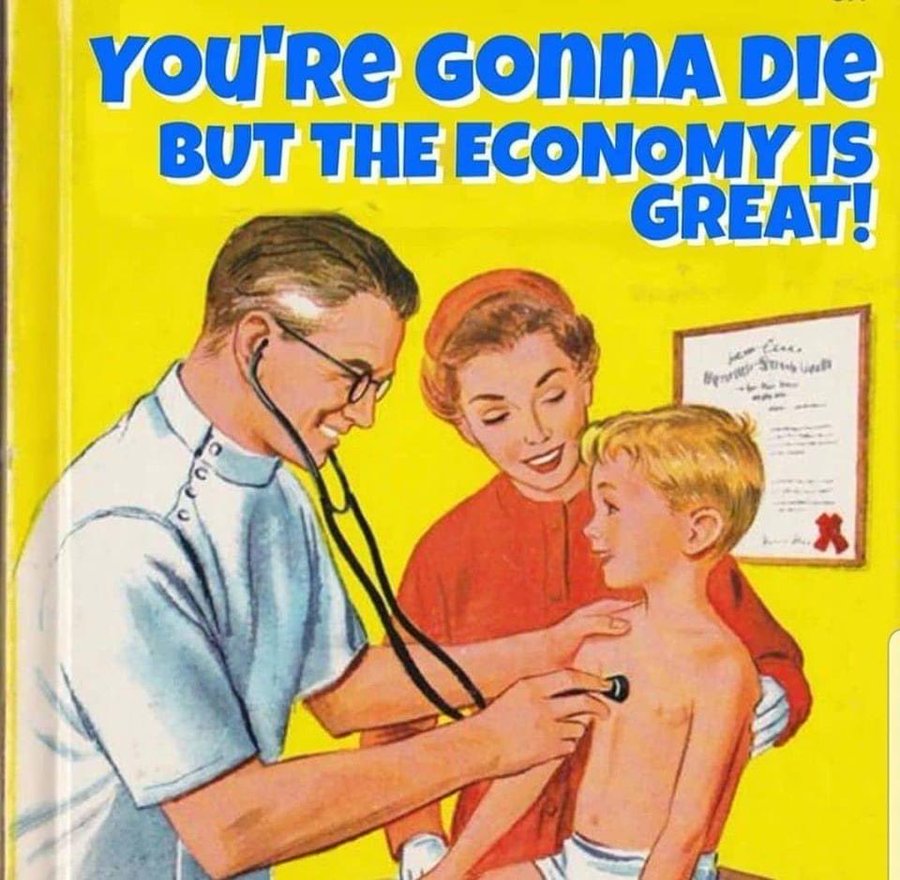Du refus d’empreinte à la préventive…
La discussion publique appelée dans ce tract, prévue initialement le 27 février au Marbré, a été empêchée de fait par la tentative d’expulsion du lieu par les flics et le proprio. Le lieu a été repris et elle pourra donc se tenir :
samedi 6 mars à 16h,
au Marbré, 32 rue des deux Communes à Montreuil
Entre temps, la première demande de mise en liberté de E. a permis sa libération (avec obligation de pointer et interdiction de manifester). C’est le reversement de ses empreintes par commission rogatoire du fichier de la prison au dossier qui s’est retrouvé décisif puisque le refus d’empreinte était le seul motif de l’incarcération. Face à ce chantage à l’incarcération visant à obtenir que nous participions à notre propre fichage, il est urgent de se réunir pour discuter du refus de signalétique, ainsi que, plus largement du refus de toutes les formes de chantages répressifs.
Samedi 20 février dernier, à Paris, une contre-manifestation était organisée pour s’opposer à la manif des fachos de Génération Identitaire. Ces racistes de merde ont pu faire leur baroud d’honneur avec sono, discours, médias & compagnie, tandis que la contre-manifestation elle, était empêchée, notamment par le biais de fouilles et de contrôles préventifs aux abords de la manif.Un de ces contrôles a eu lieu place du 18 juin 1940 à Montparnasse avant la manif qui n’a pas pu avoir lieu, elle. Les flics trouvent dans la poche d’E. un cadenas de vélo et sa clef, et décident tout naturellement de l’embraquer pour « port d’arme par destination » et « groupement en vue de commettre… », placé en garde à vue au commissariat du Ve, il est prolongé puis déferré après 48h pour passer en comparution immédiate au TGI de Paris pour les chefs d’inculpation précédents et le refus de fichage.
A l’audience, E. refuse la comparution immédiate et l’absence de fond n’est donc pas traitée, cette sale proc’ de proc’ demande alors le placement en détention sous prétexte qu’en l’absence d’empreintes digitales à comparer avec celles inscrites au FNAEG, on ne pourrait pas produire la certitude qu’il correspond bien à sa pièce d’identité, qu’il avait pourtant fournie. L’audience a donc exclusivement tourné autour de la question de comment réprimer le refus de signalétique et la sentence est venue confirmer la position militante de la proc’ et des juges en la matière, en prononçant l’incarcération automatique en dépit des garanties de représentation (qui habituellement sont prises en considération dans les procès sur la question de la mise ou non en détention) avec commission rogatoire pour prélever les empreintes.
Même jour, même audience, un fasciste belge passionné de forge de l’autre côté de la manif passait en procès (défendu par un avocat tenant à affirmer son appartenance de gauche et dont la plaidoirie consistait à dire que les échauffourées n’avaient été causées que par les antifas…). Lui, a fourni toute sa signalétique et était en possession de deux balles de 9 mm (une percutée, l’autre non) ainsi que des cartouches de masque à gaz et des fumigènes, et se présentant comme membre de l’organisation « Amis et Boucliers » (!?). Même salle, deux ambiances (2 mois avec sursis et aucune chicanerie militante dans le réquisitoire et les questions de la juge…). On ne souhaite la prison à personne et même pas à nos pires ennemis mais il était clair qu’un cadenas de vélo mettait une bien plus mauvaise ambiance que deux balles, pour ces juges, aujourd’hui. A l’issue de l’audience, cette sale juge de juge a prononcé contre E. un mandat de dépôt sous les cris de rage d’un public peu nombreux mais solidaire.
Il est primordial de réagir face à cette tentative de normaliser l’incarcération pour les refus de signalétique. En solidarité avec E. et tous les inculpés de cette manifestation, contre la préventive systématique lors des refus de signalétique, soyons nombreux :
Mercredi 3 mars 2021 à 13h30,
au TGI de Paris, chambre 23/2 pour l’audience de demande de mise en liberté
Refusons de participer à notre propre fichage !
Liberté pour tous et toutes !
Feu à toutes les prisons !
Défendons-le / Attaquons-les !
Camarades et compagnons solidaires de E.contact : mothrarising@riseup.net