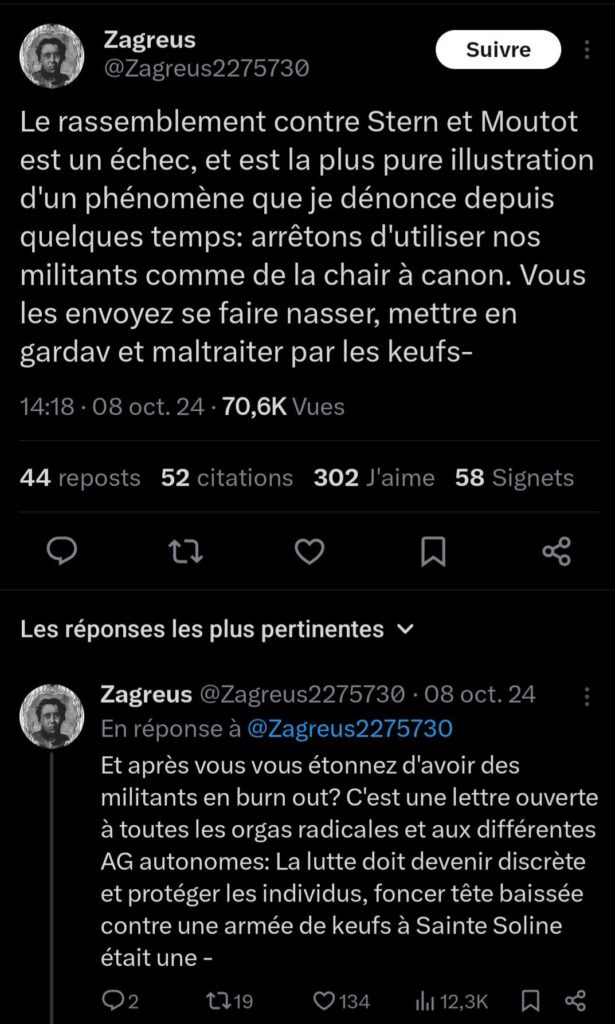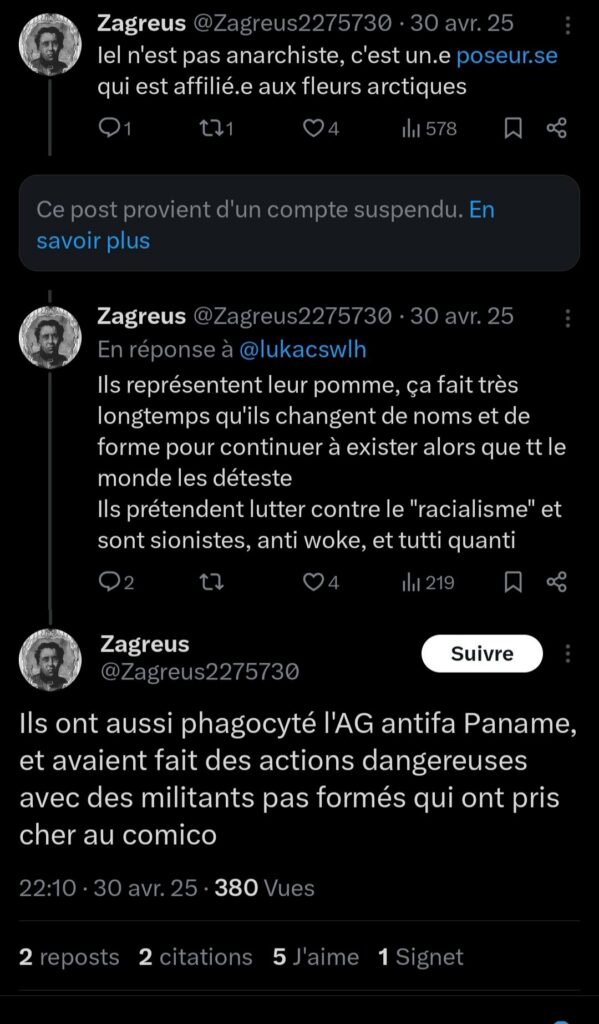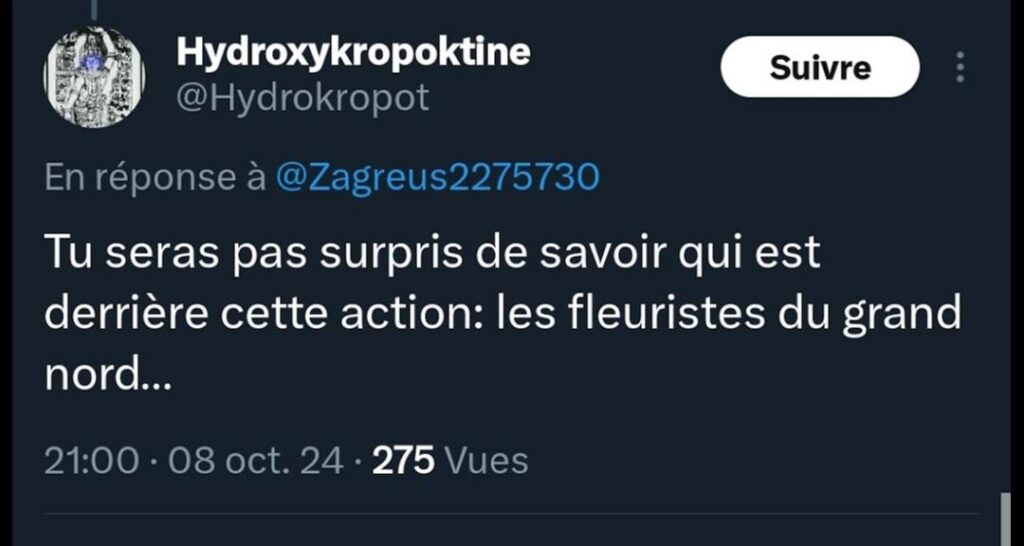Comment est-il devenu vertueux de « ne pas juger » dans une époque où la judiciarisation cherche à s’immiscer dans tous les aspects de la vie ?
Lundi 17 avril – 19h30
Dans la sociabilité courante, il semble désormais important et vertueux de « ne pas juger ». Cette règle est à tout instant relayée, y compris pour accompagner les réels jugements les plus définitifs, en forme de prétérition. Elle se propose comme la garantie du respect de l’autre et de sa singularité, et toute transgression serait dès lors un acte oppressif et autoritaire, causant un préjudice. On voudrait se demander dans quelle mesure cette injonction, qui recouvre de fait sous le terme de « jugement » toutes sortes de choses, allant, sur un nuancier un peu affiné, du point de vue, à l’opinion et passant par l’avis. Ne serait ce pas aussi (et peut-être surtout) une façon de se protéger préventivement soi-même des avis, points de vue, opinion etc. des autres. Et au final une puissante barrière contre la curiosité, le conflit et/ou la rencontre. Ce que cette injonction interdit, c’est bien la base de ce qui relie aux autres, de ce qui fait dialoguer, se rencontrer, s’apprivoiser, entrer en conflit ou s’aimer, des singularités (sauf à considérer que le lunch au taf ou l’entretien d’embauche soient des occasions adéquates…). Il est déjà curieux que le point de vue des uns sur les autres (et réciproquement) prenne ainsi une valeur absolue, une sorte de toute puissance qu’il faudrait endiguer, là où on pourrait plutôt considérer comme émancipateur de savoir accepter ou refuser, se tromper, avoir raison, contredire ou enforcer. De se faire son propre avis pour le coup, avec, contre, en tous cas aussi à partir des avis et points de vue des autres. La séparation mortifère de chacun dans le coin que le capitalisme lui a aménagé s’en retrouve renforcée. Plus besoin d’empêcher qu’il y ait des espaces pour se rencontrer, c’est la faculté de pouvoir se rencontrer qui se retrouve mutilée.
Mais cette injonction à « ne pas juger » se répercute aussi ailleurs que dans les relations interpersonnelles, où on pourrait comprendre que le jugement perpétuel des autres est un bien réel vilain défaut (mais cette injonction nous en prévient-elle?). Entre autre dans les domaines de la politique ou de l’Art, elle semble devenir quasiment naturelle. Elle prétend même au dépassement de la morale, inscrivant sa légitimité dans son rejet, puisque tout « jugement » serait à base moralisante. Alors effectivement la morale est aussi un bien réel et vilain défaut, en politique comme en Art. Elle se contente de fait de protéger et de garantir la normalité de toute perturbation, y compris émancipatrice. Soit. Mais pour autant l’époque, qui n’est pas à un paradoxe près, enjoint constamment à tester la conformité morale des avis et des points de vue formulés. Et dans la nébuleuse subversive comme au-delà on s’entend toujours très bien pour limiter cette injonction. On ne se prive pas en effet pour juger quelque œuvre ou avis qui porterait atteinte à l’identité d’autrui. Bien heureusement me direz-vous, et j’acquiescerais sans peine. Mais si l’on n’en reste au rejet de la morale juger n’est donc pas en soi faire œuvre de morale. Et il y a bien des critères qui permettent d’émettre un avis sans enfreindre cette injonction à ne pas juger. Un film de merde reste un film de merde. Mais sur quels critères se basent-on ? Les critères que l’on emploient laissent-ils une place à la subversion ? Ou au contraire n’est ce pas par ce truchement dont elle est coutumière que la morale refait surface ? Si l’on reproche à un jugement de ne pas être basé sur les bons critères on peut sans cesse se renvoyer la balle, qualifiant de moral un jugement que d’aucun considérerait esthétique et réciproquement. Tout le monde s’accordant à dire que le premier ne doit pas prendre le pas sur le second. On voudrait donc se demander si, comme dans les relations interpersonnelles, le remède ne passe pas finalement tout à fait à côté de la maladie, en produisant ses propres effets délétères. Comment penser, et peut-être avec des aspirations à penser de manière un tant soit peu radicale, c’est à dire dans une perspective véritablement critique et subversive, si avoir une opinion, un jugement, un point de vue, est en soi considéré comme moral et outrancier ? Comment ne pas voir que c’est dans les contradictions et la confrontation entre divers points de vues, jugements, opinions, éventuellement d’ailleurs chacun outrancier (la radicalité comporte cet écueil effectivement) que se tient la possibilité de la subversion, à laquelle on coupe radicalement l’herbe sous le pied si tout « jugement » est d’avance intolérable. « Les goûts et les couleurs ça ne se discute pas », certes, mais est-ce que vraiment les questions politiques, artistiques ou existentielles sont des goûts et des couleurs que chacun cultive dans son jardin privé pour décorer son intérieur fermé à toute possibilité d’intrusion ? Et puis surtout comment se débarrasser de la morale et de la Justice si on se trompe sur ce que « jugement » veut dire et si on traque la morale pile là où elle ne se tient pas ?