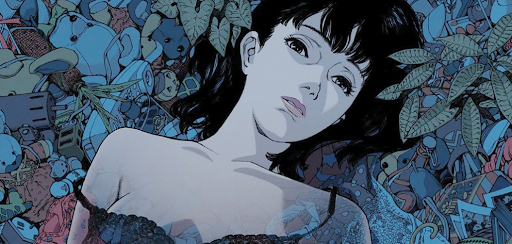Lundi 6 février 19h30

Fred M. Wilcox – 1956
VOST (USA) – 98’
Dans un cadre de science fiction de type soap opera particulièrement réjouissant, ce film culte est avant tout l’histoire d’une transgression. En 2257, John Adams, dirige son vaisseau vers la planète Altaïr IV pour porter secours aux membres d’une expédition précédente disparus dix-neuf ans plus tôt avec leur vaisseau d’exploration, le Bellérophon. Alors que le vaisseau est en approche, le professeur Edward Morbius, ancien membre de l’expédition perdue, tente de dissuader fermement John Adams de se poser sur Altaïr IV : il n’a pas besoin d’aide et il ne pourra garantir la sécurité de l’équipage. Porté par son courage indiscernablement mêlé à une curiosité qui confine à l’ubris antique, John Adams décidera pourtant d’attérir sur la planète interdite. Si nous nous intéressons à ce film culte dont le scénario parcourt un lieu commun (l’épuipe qui part porter secours à une précédent équipe d’exploration disparue), sorti en pleine guerre froide, qui marquera et initiera bien des stéréotypes du genre, ce n’est pas seulement parce que c’est le premier film de science fiction en couleur et en cinémascope, ni parce que c’est aussi le premier film de science fiction dont la bande son, grandiose, utilise exclusivement des instruments électroniques (theremine, ring modulators, etc.), ni même pour l’esthétique géniale de son robot devenu lui même culte. Si ce film nous intéresse c’est avant tout parce que, deux ans à peine après la sortie du premier Godzilla, et 20 ans après King Kong auquel son affiche fait un clin d’oeil appuyé, on peut le voir aussi comme une première exploration du kaïju allégorie de l’inconscient, auquel l’univers fantastique donne vie, puissance et capacité incontrôlable de destruction. On peut citer le film Colossal qui explore aussi cet aspect du film de Kaïju, présent de manière beaucoup moins centrale dans les autres films d’un genre auquel La Planète interdite n’est pas ouvertement rattaché, entre autres parce que c’est surtout la science fiction qu’il a marqué. Le film, qui foisonne de références hétéroclites, de King Kong pour l’affiche aux mythes antiques (Bellerophone, la Gorgone, etc.) en passant par la Tempête de Shakespeare pour le scénario ou Jules Verne pour le mystérieux et tout puissant créateur de monde Edward Morbius, sorte de Capitaine Nemo de l’espace, est surtout porté par la mise en histoire des théories de l’école psychanalytiques de Jung, ce qui le relie aussi à Crisis Jung projeté il y a quelques temps à la bibliothèque. On passera donc 1h30 à explorer les méandres inconscients de la transgression, en compagnie de « the monster from the It », « le monstre venu du ça », comme le film lui-même le nomme…